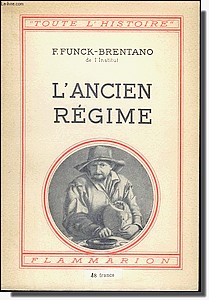
Les lettres de cachet, par Frantz FUNCK-BRENTANO, de l’Institut
Pour nos contemporains, les lettres de cachet constituent la preuve de l’arbitraire royal, le symbole du caractère tyrannique de l’Ancien Régime. Pour l’historien qui — comme Funck-Brentano — travaille sur les archives, les lettres de cachet sont une institution qui suivent une procédure complexe mais rigoureuse. Elles concernent très peu d’affaires d’État, quelques affaires judiciaires mais surtout des différends familiaux. Souvent en effet, pour éviter le scandale d’un procès, un parent ou un conjoint en appelle au roi pour isoler un temps : qui un beau-fils débauché (cas du pédophile Marquis de Sade), qui une fille dispendieuse, qui un mari infidèle, qui une femme dont l’inconduite publique déshonore la famille. Chaque demande est alors suivie d’une enquête de police et aboutit (ou pas) à une lettre de cachet. D’autres lettres de cachet sont comparables à nos « mandats d’amener » pour empêcher qu’un inculpé dans une procédure judiciaire ne s’échappe. Dans cette étude, l’académicien Funck-Brentano dresse le portrait d’une France pittoresque.
Frantz FUNCK-BRENTANO, « Les lettres de cachet », L’Ancien Régime, Éditions Flammarion, Paris, 1926, p. 112-122.
L’importance de l’institution
**Une tradition héritée des mœurs familiales de l’ancien temps [VLR]
L’histoire des lettres de cachet se lie étroitement à celle de la constitution familiale et du pouvoir royal que nous avons essayé d’esquisser dans les précédents chapitres. Elles représentent peut-être l’institution de l’Ancien Régime que, de nos jours, nous comprenons le moins, parce que notre pensée ne la place pas dans les conditions sociales, les traditions et les mœurs de l’ancien temps. Un fait est ici prédominant : pendant plusieurs siècles, non seulement nos ancêtres ne songèrent pas à protester contre l’institution dont nous allons nous efforcer de donner un croquis fidèle ; l’idée ne leur en vint même pas ; et si, dans les derniers temps de l’Ancien Régime, l’usage des lettres à cachet souleva de nombreuses et souvent véhémentes protestations, c’est que les mœurs et les traditions, dont elles étaient l’expression, s’étaient elles-mêmes transformées.
Nous avons dit les liens multiples dont l’autorité royale était entravée : les lettres de cachet étaient le seul moyen que le monarque possédât pour mettre sa volonté en activité dans le royaume, encore chacune d’elles devait-elle être contresignée d’un ministre responsable. Elles ne s’appliquaient d’ailleurs pas seulement à des ordres d’incarcération ou d’exil, mais à toutes matières où le roi désirait faire intervenir directement sa volonté, et toujours sous l’égide d’un secrétaire d’État, car, seul, le roi ne pouvait rien.
Dans les pages suivantes, il sera uniquement question des ordres du roi relatifs à l’incarcération ou à l’exil des particuliers, de ce que l’opinion générale entend par « lettres de cachet ».
**0,3% d’affaires d’État : politiques ou religieuses
Une erreur commune est de croire que l’action des lettres de cachet se bornât aux affaires d’État. Un pamphlétaire fait paraître des libelles contre les gens en place, ou contre la religion, ou contre l’autorité du roi, il est saisi et mis à la Bastille : tel est, dans l’opinion générale, le type d’une lettre de cachet. Le cas se présentait sans doute, et d’autres de même ordre ; mais ils étaient si rares qu’il est permis d’affirmer que, sur un millier de lettres de cachet délivrées par l’administration, c’est à peine si deux, trois ou quatre peut-être, concernaient une affaire de ce genre, et un historien, désireux de juger d’un coup d’œil l’ensemble de l’institution, pourrait presque les négliger.
**99,7% d’affaires de police ou d’affaires familiales [VLR]
Quelles sortes d’affaires concernaient donc les neuf cent quatre-vingt-seize ou neuf cent quatre-vingts dix-sept lettres de cachet restantes ? C’étaient habituellement des affaires de police ou des affaires de famille.
En matière de police, les lettres de cachet ne laissaient pas de rendre service, étant donné cette étonnante organisation judiciaire, dont la procédure remontait à un âge reculé, et que l’Ancien Régime conservait soigneusement. Malesherbes écrit dans un Mémoire sur le sujet qui nous intéresse :
Le juge, excepté en flagrant délit, ne peut arrêter que par décret de prise de corps, celui-ci ne se prononce qu’après information, les témoins ne sont entendus qu’après avoir été assignés, le ministre ne les fait assigner qu’après avoir obtenu la permission d’informer, et il n’obtient cette permission qu’en rendant plainte. Pendant ce temps, le coupable s’enfuit. En ce cas, le procureur général ou ses substituts demandent des lettres de cachet.
Dans ces circonstances, « l’ordre du roi » peut être assimilé au mandat d’amener que lancent nos juges d’instruction.
Procédure d’une lettre de cachet [VLR]
**Un exemple-type d’affaire familiale : l’affaire Ollivier [VLR]
Une seconde erreur est de croire que l’expédition d’une lettre de cachet fût dépourvue de toute procédure et de formalités.
Voici l’histoire d’un ordre du roi, tirée un peu au hasard de l’un des nombreux dossiers conservés dans les archives de la Bastille ; nous la raconterons avec détails, car elle a l’avantage de nous montrer d’une manière assez vivante, non seulement quelle était la procédure suivie par l’administration, mais l’esprit dont celle-ci s’inspirait, le but qu’elle poursuivait et les résultats qu’elle obtenait parfois.
Vers la fin de l’année 1750, Berryer, lieutenant général de police, recevait les plaintes de Marie-Adrienne Petit, épouse de François Ollivier, gantier-parfumeur établi à Paris, rue de la Comtesse-d’Artois. Depuis que ce dernier avait fait la connaissance d’une jeune couturière nommée Marie Bourgeois, qui logeait rue Saint-Denis-aux-Rats, tout allait sens dessus dessous dans son intérieur. La pauvre femme se disait méprisée, injuriée même par son mari, et les chalands désapprenaient le chemin d’une boutique où le patron ne faisait plus que de rares apparitions ; enfin les économies que le ménage avait réunies étaient dépensées en parures pour la coquette fille à qui maître Ollivier ne pouvait plus rien refuser.
Le lieutenant général de police dépêcha l’un de ses commissaires, un nommé Grimperel, auprès de Marie Bourgeois, avec charge de lui faire entendre raison. L’avis était bon ; mais il entrait dans une tête légère :
Cependant elle ne cesse de le recevoir chez elle, écrit Mme Ollivier dans un second placet, ce qui cause beaucoup de désordre dans notre ménage et notre commerce, et il est facile de prévoir que, si cela continue, il nous sera impossible de faire honneur à nos affaires. Ce considéré, Monseigneur, j’ai recours à vous pour vous supplier de faire enfermer Marie Bourgeois.
Ce placet au lieutenant de police est signé de Mme Ollivier et contresigné, détail important, « par le principal locataire de la maison où demeurait la jolie couturière, un nommé Charpentier ».
Le lieutenant de police mit l’affaire entre les mains de son secrétaire Chaban qui était plus particulièrement chargé de l’examen de tout ce qui concernait l’expédition des ordres du roi. L’inspecteur Dumont fut délégué pour « vérifier l’exposé du placet et en rendre compte », conjointement avec le commissaire Grimperel. Les deux officiers envoyèrent des rapports aux conclusions pareilles :
La nommée Bourgeois ne cesse de voir le sieur Ollivier, malgré les défenses qui lui en ont été faites.
Cependant, Berryer hésitait à employer le grand remède de la lettre de cachet et voulut encore tenter de ramener les coupables par un moyen plus doux. Il en écrivit au curé de la paroisse sur laquelle demeuraient nos amoureux, le priant de les faire comparaître devant lui et de tâcher, par voies persuasives, de les ramener dans le bon chemin.
Comment apprit-elle qu’il était question de la mander devant son curé ? Pour se garer de l’aventure, Marie Bourgeois changea de domicile et vint s’établir sur une autre paroisse, où ses relations, malgré de nouvelles admonestations du commissaire Grimperel, reprirent gaîment avec le parfumeur de la rue Comtesse-d’Artois. Certes, Berryer, qui mandait à son secrétaire en manière d’instructions : « Gardez les pièces jusqu’à ce qu’il vienne de nouvelles plaintes », doutait de l’effet que produiraient ces réprimandes.
Les nouvelles plaintes vinrent au mois de mai. Mme Ollivier écrit que son mari est tombé dans les pires excès, elle est certaine qu’il a conçu le projet de quitter Paris avec sa maîtresse :
Par pitié, Monseigneur faites enfermer Marie Bourgeois !
Néanmoins, Berryer ne se décida qu’après une seconde enquête par d’autres officiers de police et après un nouveau placet de la femme. Marie Bourgeois fut arrêtée le 15 juillet 1751, à neuf heures du soir, en vertu d’une lettre de cachet contresignée par le comte d’Argenson ; celui-ci était alors ministre de la Guerre avec le département de Paris. Elle fut conduite au For-l’Évêque d’où elle ne tarda pas à être transférée à la Salpêtrière. Sous les verrous de l’hôpital, la jeune fille considérait les conséquences que pouvaient entraîner les galanteries d’un parfumeur, tandis que sa famille intercédait auprès du magistrat.
En date du 20 février 1752, le lieutenant de police écrivait au secrétaire d’État ayant le département de Paris :
La sœur et la tante de Marie Bourgeois ont signé l’engagement de veiller sur sa conduite et François Ollivier celui de rompre toute relation avec elle.
Les portes de la prison s’ouvrirent. La lieutenance de police n’entendit plus parler ni de Mlle Bourgeois, ni de maître Ollivier.
Les archives de la Bastille fournissent en grand nombre des monographies d’ordres du roi semblables à celle qui précède. Celle-là peut suffire à montrer que l’expédition d’une lettre de cachet était entourée, à Paris, d’une procédure assez compliquée, qui n’était pas, à vrai dire, rigoureusement nécessaire, mais que la coutume imposait.
**La discrétion des lettres de cachet permettent de maintenir l’honneur des familles [VLR]
Mais, s’il est vrai que l’expédition d’une lettre de cachet exigeait une procédure et des formalités que la tradition avait rendues régulières et fixes, il est également vrai que toute cette procédure demeurait secrète. Voilà le plus grave reproche que l’histoire doive formuler contre cette institution. Or, chose curieuse, ce caractère secret de la procédure et des formalités qui entouraient l’expédition d’un ordre du roi ne constituait pas seulement aux yeux des contemporains l’excuse des lettres de cachet, il en faisait la raison d’être.
Le fait tenait à l’organisation de la famille dont nous avons parlé.
La raison d’être des lettres de cachet est la conservation de l’honneur des familles.
Un ordre du roi n’entraîne aucune honte pour la personne qu’il frappe, tel en est le caractère essentiel ; et c’est pourquoi il semblait nécessaire, si les raisons qui l’avaient fait délivrer touchaient à l’honneur du prisonnier, que ces raisons demeurassent secrètes.
J’ai réussi par ce moyen, écrit Berryer, à rendre service à d’honnêtes gens en sorte que les désordres de leurs parents n’ont pas rejailli sur eux.
Les affaires de mœurs [VLR]
**L’autorité royale au secours de l’autorité du père de famille [VLR]
L’ordre du roi expédié par le ministre, sur un rapport du lieutenant de police, a été sollicité par les parents de l’inculpé. C’est le père, juge de ses enfants, qui réclame l’assistance du pouvoir royal.
Le père seul, écrit Malesherbes, a le droit de demander une lettre de cachet.
Quand l’honneur de la famille est en jeu, les hommes de naissance commune ne se montrent pas moins sévères que les gens de qualité.
**L’affaire Allan [VLR]
Un vitrier nommé Allan, qui demeurait rue Neuve-Guillemain, et courait les rues de Paris, guettant les carreaux cassés, expose devant le commissaire de police qu’il a sollicité une lettre de cachet contre son fils, parce que celui-ci
lui donnait de justes motifs, par son penchant à la friponnerie, de craindre des suites infamantes pour sa famille.
L’excellent homme déclare d’ailleurs être si pauvre qu’il lui serait impossible de payer la moindre pension pour le détenu.
**L’affaire Armand [VLR]
Louis Armand, marchand éventailliste, fait enfermer sa fille Euphrosine à la Salpêtrière « parce qu’il se voit à la veille d’être déshonoré par la mauvaise conduite de cette malheureuse ». Nous pourrions multiplier les exemples indéfiniment.
**L’affaire Du Chayla [VLR]
La demande du père est rarement repoussée. Le vicomte Du Chayla sollicitait auprès du comte d’Argenson en faveur d’un ami que menaçait la colère paternelle ; mais le ministre répondait :
Il est d’usage d’arrêter les enfants dont les pères se plaignent.
**L’affaire Avisse [VLR]
La lettre de cachet délivrée, le père a le pouvoir d’en suspendre l’exécution. Jacques Avisse, qui est menuisier et demeure rue Saint-Roch, écrit à Berryer :
J’avais obtenu, il y a quelques mois, une lettre de cachet contre ma fille ; mais par tendresse paternelle j’empêchai que l’ordre fût exécuté.
Le père choisit lui-même la prison. Le fils étant en prison, le père n’en conserve pas moins sur lui plein pouvoir. Il trace le régime auquel le prisonnier sera soumis, il peut apporter des adoucissements à la peine qu’il a demandée, faire transférer le détenu d’un lieu dans un autre ; du jour au lendemain faire lever l’écrou. Nous lisons dans une lettre envoyée par Lejeune, fils d’un papetier du Marais, à sa mère :
Le Père prieur (de Charenton) m’a dit que je ne sortirais d’ici que quand mon père serait mort ; quoiqu’il me fasse de la peine, je l’aime toujours et souhaite qu’il vive plus longtemps que moi.
**L’affaire Chabrier de Laroche [VLR]
Chabrier de Laroche, capitaine réformé au régiment de cavalerie Lusignan, fils d’un président à la Chambre des comptes, fut conduit dans les prisons du For-l’Évêque, sur un placet de son père, le 24 octobre 1751. Le 12 novembre suivant, le père demanda la mise en liberté du prisonnier, mais avec un ordre du roi qui le reléguerait à la suite de son régiment ; ce qui fut accordé, et le jour même où le jeune homme sortait de prison, à savoir le 14 décembre, le père obtenait une seconde lettre de cachet qui lui donnait pouvoir de faire arrêter à l’avenir son fils, s’il venait à quitter son régiment, en quelque lieu qu’il se trouvât, et de le faire mettre en prison pour vingt ans.
**De l’autorité du chef de famille : père, mère, frère, oncle, cousin ou même ami [VLR]
En l’absence du père, c’est la mère qui rédige la requête, et, en l’absence des père et mère, les principaux membres de la famille, frères, oncles, cousins, les amis mêmes de la maison réunissent leurs signatures pour obtenir une lettre de cachet contre un libertin qui, par sa mauvaise conduite, menace de ternir l’éclat d’un nom respecté. Le pouvoir de la mère est encore, très grand devant l’administration, surtout lorsqu’il s’agit d’une fille.
**L’affaire Flaubert [VLR]
Catherine Flaubert, veuve de Pierre Fontaine, ouvrier plombier, âgée de soixante-dix ans, « ayant une fille qui lui avait désobéi pour vouloir épouser un garçon malgré elle, se vit obligée de la faire mettre, par ordre du roi, à la maison de force de la Salpêtrière ». La mère ayant soixante-dix ans, quel pouvait bien être l’âge de la fille ?
**L’affaire Bouillette [VLR]
En 1751, Thomas Bouillette, compagnon menuisier, est écroué à Bicêtre en vertu d’une lettre de cachet sollicitée par sa mère, la veuve Bouillette, tripière. Celle-ci expose que
la famille fait profession d’honnêtes gens et a des craintes des suites fâcheuses en fréquentation des libertines.
Le jeune homme était à Bicêtre depuis plusieurs semaines, que la mère adressa au lieutenant de police une nouvelle supplique. Son fils, dit-elle, désirerait s’engager pour la compagnie des Indes ; « mais la famille affligée craint qu’il ne cherche qu’une occasion de s’évader », et demande « qu’il soit conduit aux Isles avec les déserteurs, enchaîné ». La veuve Bouillette ajoute qu’elle offre de payer entièrement le voyage, « préférant ce sacrifice à la douleur d’être déshonorée par un libertin ». La demande fut accordée.
**L’affaire Jante [VLR]
À peine est-il besoin de dire que les questions de mœurs occupent la plus grande place parmi les motifs dont les solliciteurs appuient leurs placets. Georgette Leloir, femme d’un ouvrier du « faubourg Antoine », a une fille qui s’est consolée de la mort de son mari, maître Jante, sans procéder aux formalités que prescrivent les règles de l’Église et les lois de l’État. Elle vit avec un archer du guet et « la pauvre mère affligée a vainement essayé de les faire marier ensemble » ; aussi demande-t-elle
que sa fille soit enfermée dans les lieux où sont enfermées les débauchées.
Louise Jante fut incarcérée à la Salpêtrière le 18 janvier 1752. Aussitôt l’archer se déclara disposé à épouser sa maîtresse, et la mère de consentir à la liberté de sa fille, mais sous condition que le mariage serait célébré avant la sortie de la prisonnière, dans la chapelle même de l’Hôpital général. Tout semblait sur le point de s’arranger ; l’on comptait sans le père du futur. Dans une lettre signée « Clément », celui-ci repousse l’affront de voir un de ses fils se marier dans une prison et met comme condition à son consentement que le mariage soit célébré dans l’église voisine de Saint-Paul. La mère se montra accommodante, et l’Administration alla jusqu’à fournir les témoins.
Les affaires d’argent [VLR]
**Préserver les familles de la ruine [VLR]
Les plaintes formulées par les parents, pour faire enfermer leurs enfants, portent presque toujours, comme nous venons de le dire, sur des affaires de mœurs ; d’autres fois, sur de folles dépenses : éternelle histoire du jeune héritier qui, pour les beaux yeux d’une jolie fille, engage le bien paternel dans les griffes d’un usurier. Les lettres de cachet venaient au secours d’un beau-père qu’effrayaient les prodigalités de son gendre.
**L’affaire Brisay [VLR]
Le marquis de Brisay est un ancêtre de Gaston de Presle, gendre de M. Poirier. Jeune, il avait aimé le luxe et les grandes dépenses, et bientôt il s’était vu au bout de son rouleau d’écus. Alors, il avait trouvé une bonne famille bourgeoise, très riche et glorieuse, que son titre de marquis éblouit et qui lui donna une belle demoiselle avec une dot plus belle encore. Et les dépenses de reprendre grand train. Le beau-père, qui se nommait M. Pinon, pour charmé qu’il fût d’entendre appeler sa fille Madame la marquise, n’en fronça pas moins les sourcils en voyant la dot si lestement dépensée par le mari. Il prit les enfants chez lui, serra les cordons de sa bourse ; le marquis fit des dettes, M. Pinon se fâcha, puis demanda une lettre de cachet. Nous l’avons sous les yeux, elle est datée du 24 janvier 1751, signée Louis, contresignée d’Argenson, et envoie le marquis de Brisay à la citadelle de Lille. Celui-ci se rendit, en toute liberté, dans sa prison, où il arriva, accompagné d’un domestique le 3 février. Le premier mois, tout alla bien, le marquis paya ses fournisseurs ; mais les deux mois suivants n’étaient pas écoulés que Brisay devait des sommes importantes à l’hôtelier, aux fournisseurs, aux officiers de la garnison. M. de La Basèque, gouverneur de la citadelle de Lille, en écrit au lieutenant de police et demande que la famille, c’est-à-dire le beau-père du marquis de Brisay, ajoute annuellement mille livres aux deux mille que ses créanciers lui abandonnent. On en informa M. Pinon qui se récria : c’était trop cher ! Dans une deuxième lettre adressée au secrétaire d’État, peu de temps après la première, M. Pinon représente le séjour de son gendre à la citadelle de Lille, « dont l’auberge est toujours pleine d’officiers et de filles comédiennes », comme étant de nature à entraîner le prisonnier à des dépenses. Il demande que le marquis soit transféré au fort de l’Escarpe-lez-Douai ou au fort Saint-François, près d’Aire.
L’honneur du nom [VLR]
**Protéger la famille du scandale d’un procès [VLR]
Les circonstances où les lettres de cachet n’expliquent le mieux, les seules où l’esprit moderne puisse les admettre, c’est quand elles ont eu pour but de soustraire un coupable à la terrible jurisprudence de l’époque, appliquée par les tribunaux, Châtelet ou Parlement, et d’épargner à toute une famille la réprobation qu’aurait entraînée pour elle une condamnation toujours prononcée avec appareil et éclat. L’action des lettres de cachet, se greffant de la sorte sur l’action judiciaire, est particulièrement intéressante à étudier dans la classe populaire.
**L’affaire Bunel [VLR]
Au cours d’un rapport au lieutenant de police rendant compte d’une patrouille faite le 31 janvier 1751, dans le quartier Saint-André-des-Arts, l’inspecteur Poussot exposait que l’on avait arrêté un nommé François Bunel, soldat aux gardes françaises, dans une sanglante bagarre au fond d’un cabaret ; puis, il se découvrit que cet individu était chargé de plusieurs vols et qu’il vivait associé à une fille de la pire espèce. Aussi fut-il recommandé d’ordre du roi au Grand-Châtelet ; mais sa mère, qui était veuve d’un soldat aux gardes françaises, pour éviter à son fils et à toute sa famille la honte d’une condamnation prononcée par le tribunal, parvint à s’arranger avec la partie civile, et obtint que le président de Boulainvilliers lui-même, chez qui avait été commis l’un des vols, écrivît au procureur du roi pour demander, conjointement avec la famille, que Bunel pût s’engager pour les îles ou fût enfermé par lettre de cachet à Bicêtre, ce qui l’enlèverait à la juridiction du Châtelet. Ainsi fut fait. Les sergents recruteurs pour le régiment de Briqueville trouvèrent notre homme à Bicêtre. Il était de bonne taille, et le lieutenant de police l’autorisa à contracter un engagement avec eux. Une lettre de cachet en date du 22 mars leva l’écrou du prisonnier, tandis qu’une autre l’exilait à la suite du régiment de Briqueville-infanterie dans lequel il allait prendre rang. Nous restons une année et demie sans nouvelles. Le 4 novembre 1752, le marquis de Briqueville écrivit à Berryer pour le prier de lever l’ordre d’exil qui pesait sur Bunel. Celui-ci, disait-il, n’avait cessé de se comporter comme un excellent sujet, n’avait jamais encouru le moindre reproche, et ses chefs avaient à cœur de lui donner de l’avancement, ce qui n’était pas possible tant qu’il était sous le coup d’une lettre de cachet. Il demande son rappel, ayant à dessein de le faire sergent. M. le comte d’Argenson est supplié de faire expédier un ordre nécessaire à cet effet. Ce rapport porte en apostille, de la main du ministre :
Bon pour le rappel, 3 décembre 1752.
Pour comprendre la portée de cette courte monographie, il faut connaître les sévérités des tribunaux de ce temps que les philosophes ne cessent de signaler et dont Voltaire parle en ces termes :
Ils étaient les conservateurs d’anciens usages barbares contre lesquels la nature effrayée réclamait à haute voix. Ils ne consultaient que leurs registres rongés des vers. S’ils y voyaient une coutume insensée et horrible, ils la regardaient comme une loi sacrée. C’est par cette raison qu’il n’y avait nulle proportion entre les délits et les peines. On punissait une étourderie de jeune homme comme on aurait puni un empoisonnement ou un parricide.
**Une justice moins sévère que les parents eux-mêmes [VLR]
Mais le lieutenant de police jugeait souvent les parents trop sévères et, au lieu de la lettre de cachet sollicitée, mandait dans son cabinet le père et la mère, avec la jeune personne qui n’en voulait faire qu’à sa tête. La jeune fille écoutait les réprimandes du magistrat, et au lendemain, nonobstant la menace d’une lettre de cachet qui devait punir sa désobéissance, en aimait davantage son amoureux. Ces épisodes d’un caractère paternel et gracieux nous offrent la vivante peinture de l’époque.
**Une société solidaire aux liens très forts [VLR]
Lorsque les parents négligeaient d’intervenir pour réprimer les désordres de leurs enfants, il arrivait que des locataires de la maison, des voisins, des personnes du quartier envoyaient à la lieutenance de police l’expression de leur indignation. Ces détails sont précieux pour l’histoire de la population parisienne en ce temps.
Les curés placés à la tête des différentes paroisses de Paris jouent un rôle important dans l’histoire des lettres de cachet. Le zèle mis par eux à ramener celles de leurs ouailles qui se sont égarées dans la voie du siècle les conduit parfois à des rigueurs excessives.
**L’affaire Velvrique [VLR]
Jeanne Velvrique avait, en 1751, vingt et un ans. Elle était, pour nous servir des expressions de l’abbé Feu, curé de Saint-Gervais, « douce et timide, gracieuse et jolie ». Une « femme du monde » s’empara de son esprit et lui procura la protection d’un Américain. Le curé intervint :
L’Américain a parlé raisonnablement, écrit-il au lieutenant de police, à deux personnes que je lui ai envoyées.
Tout allait s’arranger quand on découvrit que cet homme raisonnable n’était pas seul à faire le bonheur de la demoiselle et qu’un nommé Lheureux, facteur des lettres de la Salpêtrière, « homme pernicieux », écrit le vieux prêtre, n’était pas en moins bonne posture dans son cœur et dans ses faveurs et beaucoup moins disposé à y renoncer.
Je réclame ma brebis, écrit le curé de Saint-Gervais au lieutenant de police, et j’espère que vous aurez la bonté de la faire arrêter et mettre à Saint-Martin, où elle se convertirait, puis je la mettrais dans un couvent.
Il faut noter que Saint-Martin était la plus rude prison pour femmes qu’il y eût à Paris. Berryer manda au commissaire de Roche-brune de s’informer des faits :
Quelle est la conduite de la jeune fille ? si elle cause du scandale, si elle a des parents, si elle loge chez eux, et dans le cas où il faudrait la corriger, si ses parents sont en état de payer une pension ?
Rochebrune répondit sur ces différents points : les parents étaient pauvres et la jeune fille les avait quittés depuis la première semaine de carême ; il ajoutait qu’ayant appris les démarches de l’abbé Feu elle avait fait une demande pour entrer à l’Opéra,
afin d’être défendue contre son curé par les privilèges de l’Académie royale de musique.
Une petite danseuse, une choriste de l’Opéra, engagées par cela même au service du roi, ne pouvaient plus être frappées d’une lettre de cachet. Mais Jeanne Velvrique n’eut pas le temps de mettre son projet à exécution : elle fut arrêtée le 22 février 1752. En prison, elle s’empressa à s’adresser aux protecteurs qu’elle ne laissait pas d’avoir. M. de Duras sollicita chaudement auprès du lieutenant de police, la mère de la jeune fille joignit ses prières aux instances du noble duc, et le curé de Saint-Gervais consentit à ce que Jeanne sortît de Saint-Martin, mais à condition qu’elle passerait quelques mois, avant d’être rendue entièrement libre, dans la communauté du Bon-Sauveur :
Je compte sur l’influence de la Supérieure, écrit le vieux prêtre, pour sauver cette brebis égarée.
Les dissentiments conjugaux [VLR]
**Des maris et des femmes souhaitant faire enfermer leur conjoint [VLR]
Très nombreux — il fallait s’y attendre — sont les maris désireux de faire enfermer leur femme et plus nombreuses encore les femmes qui veulent faire enfermer leur mari. Aussi bien est-ce toujours l’honneur de la famille qui est en jeu. Le bruit mené autour d’une affaire de mœurs plaidée en Parlement était peut-être plus grand en ce temps qu’aujourd’hui. Un procès en séparation de corps défrayait la chronique des ruelles.
Le public, écrit d’Argenson, est charmé de la scène qu’on lui donne et personne n’a la charité de tirer le rideau pour cacher un spectacle si ridicule.
Les avocats avaient pris l’habitude de faire imprimer des mémoires, réquisitoires, plaidoyers, qu’ils faisaient distribuer à grand nombre d’exemplaires et mettaient en vente dans Paris. On se les passait de main en main. Dans le coin du boudoir, ils étaient lus par Clitandre, qui les assaisonnait de commentaires, aux éclats de rire de Célimène et du marquis. L’arrêt des juges était de même imprimé avec les considérants, et l’on entendait les colporteurs, camelots de l’époque — ils foisonnaient déjà dans Paris — les crier par les rues et jusque devant la maison des intéressés.
Une remarque s’impose au sujet des lettres de cachet sollicitées par l’un des époux contre l’autre. L’ordre du roi était obtenu beaucoup plus facilement par le mari contre la femme que par la femme contre le mari, ce qui n’empêchait pas les lettres de cachet contre les maris d’être plus nombreuses, par la raison, constate Malesherbes, qu’elles « étaient sollicitées avec beaucoup plus d’ardeur que toutes les autres ».
**L’autorité du roi au secours des ménages : l’affaire Beaudoin [VLR]
L’autorité du roi intervenait dans les ménages, lors même qu’il n’y avait pas scandale, ainsi qu’en témoignent les rapports du lieutenant de police d’Argenson, où se trouvent tant d’observation et d’humour :
Une jeune femme, écrit-il, nommée Beaudoin, publie hautement qu’elle n’aimera jamais son mari et que chacun est libre de disposer de son cœur et de sa personne comme il lui plaît. Il n’y a point d’impertinences qu’elle ne dise contre son mari, qui est assez malheureux pour en être au désespoir. Je lui ai parlé deux fois, et, quoique accoutumé depuis plusieurs années aux discours impudents et ridicules, je n’ai pu m’empêcher d’être surpris des raisonnements dont cette femme appuie son système. Elle veut vivre et mourir dans cette religion, il faut avoir perdu l’esprit pour en suivre une autre, et plutôt que de demeurer avec son mari elle se ferait huguenote ou religieuse. Sur le rapport de tant d’impertinences, j’étais porté à la croire folle ; mais, par malheur, elle ne l’est pas assez pour être enfermée par la voie de l’autorité publique, elle n’a même que trop d’esprit, et j’espérais que, si elle avait passé deux ou trois mois au Refuge, elle comprendrait que cette demeure est encore plus triste que la présence d’un mari que l’on n’aime pas. Au reste, celui-ci est d’une humeur si commode qu’il se passera d’être aimé pourvu que sa femme veuille bien retourner chez lui et ne pas lui dire à tous moments qu’elle le hait plus que le diable. Mais la femme répond qu’elle ne saurait mentir, que l’honneur d’une femme consiste à dire vrai, que le reste n’est qu’une chimère et qu’elle se tuerait sur l’heure si elle prévoyait qu’elle dût jamais avoir pour son mari la moindre tendresse.
Ces motifs d’incarcération se répètent avec uniformité : fantaisies extra-conjugales, dissipation des deniers de la communauté, mauvais traitements, et souvent délits de droit commun passibles des tribunaux auxquels on veut soustraire les coupables.
**Quand une épouse s’adonne à l’alcool [VLR]
Un mari fait enfermer sa femme qui s’est éprise d’un trop vif amour du dieu Bacchus. Quand l’inconduite de la femme a pour témoins des enfants, surtout des filles d’un certain âge, la demande n’est jamais repoussée.
**Le conjoint plaignant peut toujours abréger la détention de l’époux ou de l’épouse [VLR]
L’un des époux en prison, l’autre conservait le pouvoir de régler son régime, de le faire transférer dans un autre lieu si ce dernier lui paraissait plus sûr. Le mari demeurait juge du moment où l’on mettrait sa femme en liberté et réciproquement.
**Des situations pittoresques [VLR]
D’aucuns, trop sceptiques, ne s’étonneront pas que des hommes, enfermés sur les insistances de leurs femmes, aient demandé à rester en prison lorsque celles-ci vinrent les réclamer. Taschereau de Baudry, lieutenant de police, écrit en date du 6 septembre 1722 au ministre de Paris :
Michel Arny demande de rester à l’Hôpital le restant de ses jours, assurant qu’il y sera plus heureux qu’avec sa femme.
Des abus [VLR]
L’institution des lettres de cachet engendrait d’ailleurs de grands abus, à cause de la place prépondérante laissée à l’opinion personnelle des hommes chargés d’en faire l’application et à cause des procédures entièrement secrètes dont elle s’entourait.
En 1713, un garde du corps, Du Rosel de Glatigny, « gentilhomme de l’Isle de France », écrivit au ministre, demandant un ordre pour faire enfermer Marie Du Rosel, sa fille, âgée de dix-neuf ans, dans une maison de force à Paris. Il exposait que celle-ci voulait épouser un « trompette », au préjudice d’un garde du corps qui l’avait demandée en mariage. Par mesure de prudence, disait-il, et pour épargner à sa fille les fleurettes du galant, il l’avait déjà placée dans un couvent à Meaux ; mais il avait toutes raisons de craindre que le jeune homme ne l’enlevât, ayant appris que celui-ci avait déjà trouvé le moyen de l’y voir et de lui parler.
Le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, fut prié de donner son avis, et répondit que les communautés religieuses étaient impropres à garder ces sortes de filles, qu’elles ne s’y corrigeaient point et corrompaient souvent les religieuses, qu’il n’y aurait de sûreté qu’en la plaçant dans une maison de force où on pourrait la cacher et que la maison de Sainte-Pélagie, autrement dit le Refuge, semblait la plus convenable dans le cas présent. Marie Du Rosel fut transférée du couvent où elle était dans la prison de Paris. Peu après, le ministre reçut une lettre très vive de Mme de Richelieu, supérieure du couvent de Meaux ; elle rendait le meilleur témoignage au sujet de la jeune fille, qu’elle disait connaître pour pieuse et sage et qui, loin de se laisser courtiser par des soldats, était dans la disposition de se faire religieuse ; mais que le père, désireux de jouir du bien que Marie Du Rosel tenait de sa mère, l’avait fait transférer à Sainte-Pélagie, dans l’espoir qu’on l’y garderait pour le restant de ses jours.
D’Argenson, chargé de vérifier les faits, manda devant lui Du Rosel, le pressa de questions, si bien qu’il le contraignit d’avouer qu’il n’avait aucune preuve de tout ce qu’il avait avancé. L’émotion fut grande et l’on voulut punir le gentilhomme sévèrement. Marie Du Rosel rentra au couvent de Meaux, d’où elle sollicita la grâce de son père.
La fin des lettres de cachet [VLR]
Le 16 mars 1790, sur l’initiative du roi, l’Assemblée Constituante effaça de nos lois cette institution d’un autre âge : elle accomplit une œuvre juste et saine aux applaudissements de la France et de l’Europe entière.
Il est toutefois curieux de constater que, si toute la France en vint à se soulever contre le régime des lettres de cachet, la Révolution trouva sa force et sa cause même dans ce qui avait fait la force et la raison première de cette institution. N’a-t-on pas été frappé par le caractère de ce peuple parisien que l’histoire des lettres de cachet fait apparaître sous un jour si remarquable ? En signalant l’ardeur avec laquelle ces ordres étaient sollicités et les motifs qui dictaient les requêtes, Malesherbes, qui avait eu à les étudier particulièrement en qualité de ministre de la maison du roi, écrit ces paroles mémorables :
Dans une famille patricienne, on est indigné contre un jeune homme qui déroge à sa naissance. Les plébéiens ont d’autres préjugés qui sont peut-être fondés sur une morale très saine, mais auxquels ils sont attachés avec trop de rigueur. Il y a des fautes que tout le monde blâme, mais que les gens de condition et ce qu’on appelle les gens du monde regardent comme pardonnables et qui, au jugement d’une famille bourgeoise, sont des délits qu’on ne peut excuser.
La cause apparente, le prétexte de la Révolution a été l’arbitraire de l’Ancien Régime, caractérisé par les lettres de cachet ; la cause réelle, la cause sociale en a été dans le maintien au sein du peuple de ces mœurs saines et fortes, puissantes de moralité et d’un rigide sentiment de l’honneur, que nous a révélées l’étude des lettres de cachet ; et le peuple fut amené à se soulever contre un gouvernement et une classe dirigeante qui, pour avoir perdu la tradition de ces mœurs, laissaient apparaître dans leurs actes qu’ils étaient devenus incapables de tenir le rôle qui leur incombait.
MabBlavet
Articles de cet auteur
- Discours sur la Révolution, par Alexandre Soljenitsyne aux Lucs-sur-Boulogne (1993)
- Été 2018 : Les combats de Louis XX pour l’unité nationale et la famille
- La prise de la Bastille le 14 Juillet 1789, par Frantz FUNCK-BRENTANO
-
Nature et propriétés de l’autorité royale, par
Bossuet - De l’autorité : que la royale et héréditaire est la plus propre au gouvernement, par BOSSUET
- [...]
Mots-clés
- Ancien régime
- Frantz Funck-Brentano
-
Histoire
- La prise de la Bastille le 14 Juillet 1789, par Frantz FUNCK-BRENTANO
- LYON, ville martyre de la 1re République, par Louis-Marie PRUDHOMME (1797)
- Boniface VIII et Philippe le Bel : Les protagonistes et leurs argumentaires
- Petite histoire de la légitimité de 1883 à nos jours
- Boniface VIII et Philippe le Bel : chronologie de la querelle
- Sociologie politique